Catégorie : Livres
-
Les yeux de la ville : vigilance et lien social France-Japon, analyses croisées
→ Le livre chez l’éditeur Naoko Tokumistu, « Les Yeux de la ville : vigilance et lien social France-Japon, analyses croisées », Hémisphère, Paris, 2021, 568p. En réponse à un sentiment croissant d’insécurité, les actions de prévention initiées par des particuliers se multiplient. Ce livre étudie leur récent développement à l’échelle du quartier, en France et au Japon, et en…
-

De proches amis venus de loin: amitiés dans l’Asie orientale
→ La revue en ligne Il faut, entend-on dire souvent de parents inquiets, bien choisir ses amis. Et l’on comprend par là, dans un savoir d’expérience qui s’est imposé aux aînés et qu’ils ont eux-mêmes appris de leur père et de leur mère, qu’il faut éviter les « mauvaises fréquentations », délétères, corruptrices et qui font irrémédiablement dévier…
-
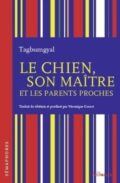
Le Chien, son maître et les parents proches
→ Le livre chez l’éditeur Tagbumgyal, Le Chien, son maître et les parents proches, Semaphores, Paris, 2020, 144 p., traduit du tibétain par Véronique Gossot Dans l’univers de Tagbumgyal, où quelques touches de fantastique viennent parfois perturber le réalisme, parler des chiens c’est parler des hommes. Portée par un sens aigu de l’observation, la narration imagée (voire…
-
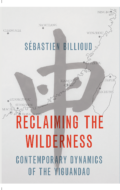
Reclaiming the Wilderness, Contemporary Dynamics of the Yiguandao
→ Le livre chez l’éditeur Sébastien Billoud, Reclaiming the Wilderness, Contemporary Dynamics of the Yiguandao, Oxford University Press, Oxford, 2020, 312 p. A syncretistic and millenarian religious movement, the Yiguandao (Way of Pervading Unity) was one of the major redemptive societies of Republican China. It developed extremely rapidly in the 1930s and the 1940s, attracting millions…
-
Le bambou au Vietnam. Une approche anthropologique et historique
→ Le livre chez l’éditeur Đinh Trọng Hiếu & Emmanuel Poisson, Le bambou au Vietnam.Une approche anthropologique et historique, Paris : Hémisphère-Maisonneuve et Larose nouvelles éditions, « Asie en perspective », 2020.
-

La place des maternels dans la Chine patrilinéaire. Enquête dans un village du Jiangxi (Chine du Sud-Est)
→ Le livre chez l’éditeur → Le chapitre sur OpenEdition CAPDEVILLE-ZENG Catherine, « La place des maternels dans la Chine patrilinéaire. Enquête dans un village du Jiangxi (Chine du Sud-Est) », in Le façonnement des ancêtres, Paris : Inalco Presses.
-
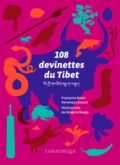
108 devinettes du Tibet
→ Le livre chez l’éditeur ROBIN Françoise, GOSSOT Véronique (2019), 108 devinettes du Tibet. Paris : L’Asiatèque, 264 p. Le jeu des devinettes occupe une place privilégiée dans la vie des Tibétains. A ce jour aucune traduction dans une langue occidentale n’a été faite de ces devinettes et la publication de ce livre contribue à…
-
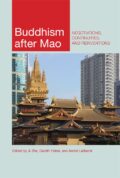
Buddhism after Mao : Negotiations, Continuities, and Reinventions
→ Le livre chez l’éditeur JI Zhe, FISHER Gareth, et LALIBERTE André (2019), Buddhism after Mao : Negotiations, Continuities, and Reinventions. Hawaï : University of Hawai’i Press, 364 p.